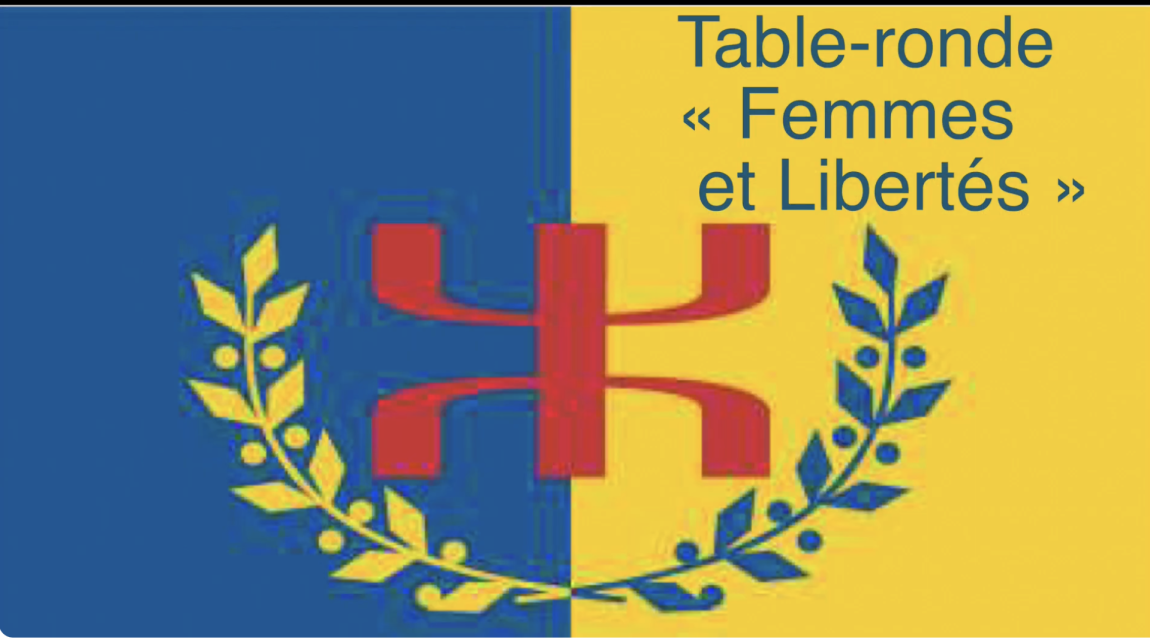
La lutte millénaire des femmes kabyles pour la liberté
Réalisation : ABP – 3297 vues
Samedi 25, au Festival du livre en Bretagne à Carhaix, une table ronde Femmes et Libertés a réuni trois intervenantes pour raconter, depuis la Numidie antique contre Rome jusqu’à aujourd’hui contre l'islamisme et les autorités algériennes, la continuité d’une résistance des femmes en Kabylie : linguistique, politique, spirituelle, culturelle et intellectuelle. Une rencontre d'un haut niveau académique et vécue, où l’histoire, l’enquête et...
Elles ont tenu tête : 2 000 ans de courage des femmes kabyles
Historienne des religions et des géopolitiques africaines, Charlotte Touati ouvre la séance par un panorama historique : de Sainte Perpétue – première autobiographe martyre en latin, originaire de Numidie – à Dihya / la Kahina (VIIᵉ s.), en passant par Yemma Khelidja (période ottomane) et Fatma N’Soumer (XIXᵉ s.). Autant de figures où s’imbriquent autorité spirituelle et commandement militaire, et dont la mémoire populaire kabyle demeure « agissante ». « À chaque tentative de colonisation… des figures de résistance féminine se distinguent », rappelle l’historienne.Touati insiste : la toponymie et les sanctuaires de montagne perpétuent ce syncrétisme kabyle, en tension avec les orthodoxies imposées. Elle recadre aussi des récupérations contemporaines (lecture nationaliste a posteriori de Fatma N’Soumer) et souligne que le rôle des femmes dans la guerre d’indépendance a été largement effacé après 1962.
« Du martyre de Sainte Perpétue à Amel Zenoune Zouani, se dessine une histoire continue du courage féminin amazigh. »
Années 1990 : les visages assassinés de la liberté
La présentation de Charlotte Touati s’achève sur la décennie noire en Algérie : Katia Bengana (égorgée pour avoir refusé le voile), Amel Zenoune Zouani (étudiante en droit, assassinée par le GIA en 1997), et d’autres jeunes femmes tuées parce qu’elles étudiaient, circulaient, vivaient à visage découvert. Des noms et des visages, projetés en salle, qui donnent chair à l’argument : l’éducation fut et demeure un acte de libération.Islamisation des esprits : un témoignage de terrain depuis Bruxelles
Fadila Maaroufi, doctorante (ULB) et travailleuse sociale de terrain, décrit quarante ans de transformations à Bruxelles : financement étrangers de mosquées, arabisation scolaire, montée des réseaux fréristes et récupération idéologique de figures historiques berbères. Elle raconte comment des adolescentes, d’abord meilleures élèves parce que confinées, ont été ciblées par des discours d’“empowerment” sous contrainte : on valorise leurs études… mais « toujours dans les règles », jusqu’à envisager un retour au foyer lorsque « la loi islamique » dominera.« On nous a inculqué un islam rigoriste et on a voulu effacer nos mémoires. »Elle parle aussi de violences intrafamiliales tues, de pression normative quotidienne (« par respect, mets le voile »), et d’une mort sociale pour ceux qui s’opposent. Témoignage poignant : deux de ses frères se sont radicalisés, dit-elle, et elle-même a dû quitter Bruxelles après des menaces.
Marché, culture, droit : l’autre front idéologique
L’anthropologue Florence Bergeaud-Blackler replace la ré-islamisation européenne dans le temps long : arrivée des Frères musulmans, stratégie visant les campus dans les années 1990, et mobilisation des femmes et des jeunes comme relais d’influence. Elle développe le concept de « djihad par le marché » : un écosystème halal (alimentation, cosmétiques, médicaments, mode pudique, tourisme, etc.) qui norme les pratiques et segmente l’espace social au nom de la pureté, pendant que le djihad judiciaire et l’entrisme associatif-politiques avancent masqués.« La réforme islamique ne pourra réussir sans la participation des femmes, car ce sont elles qui éduquent les générations futures. » (rappel de la doctrine frériste)
Q&R : naïveté, clientélisme et lignes rouges républicaines
Le débat avec la salle file sur trois thèmes :- Naïveté passée, complaisance présente des pouvoirs publics et d’une partie des partis, électoralisme et « partis coucous » où s’abritent des cadres fréristes. Les partis de gauche comme LFI veulent récupérer le vote musulman.
- Lignes rouges proposées : interdiction du voile pour les mineures, défense stricte de la mixité (considérée comme « socle » de la société ouverte) et fin du deux-poids deux-mesures dans l’application du droit.
- Kabylie aujourd’hui : inquiétudes sur la fermeture d’églises protestantes, pressions sur les libertés de culte et effacements culturels (tatouages, syncrétismes), évoqués par le public et les intervenantes.

Commentaires (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir !